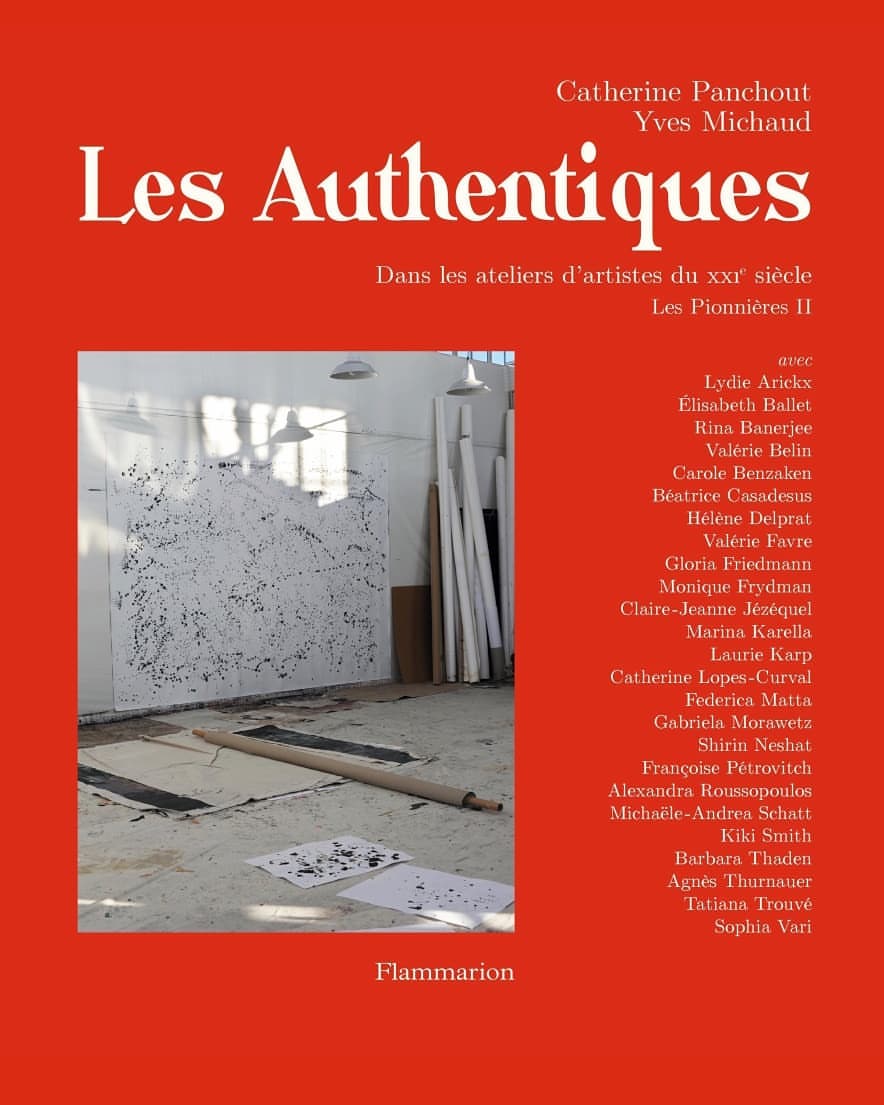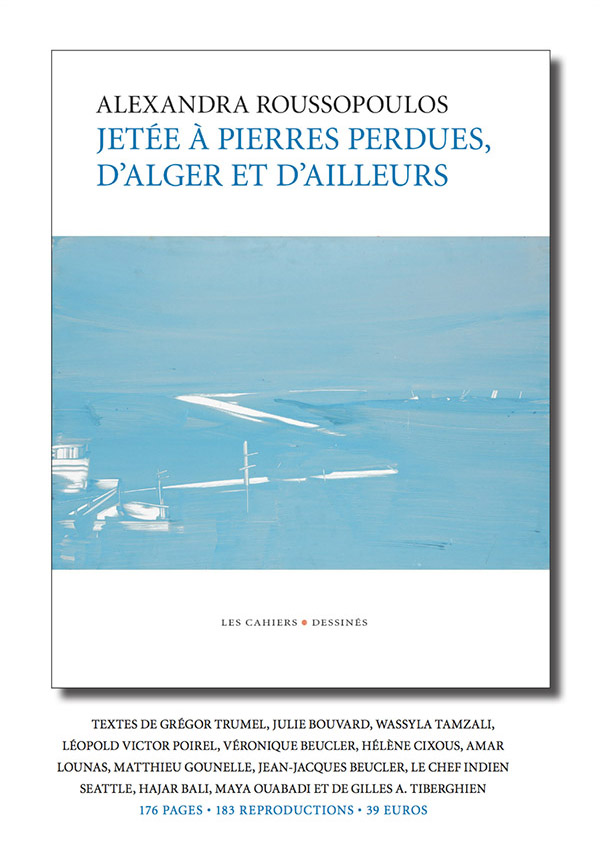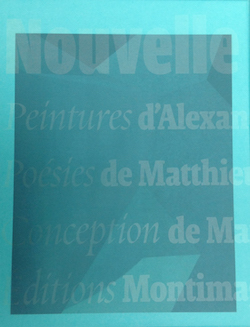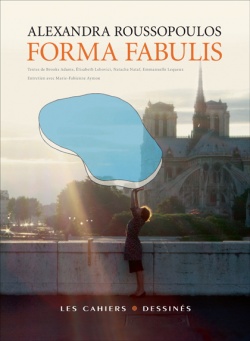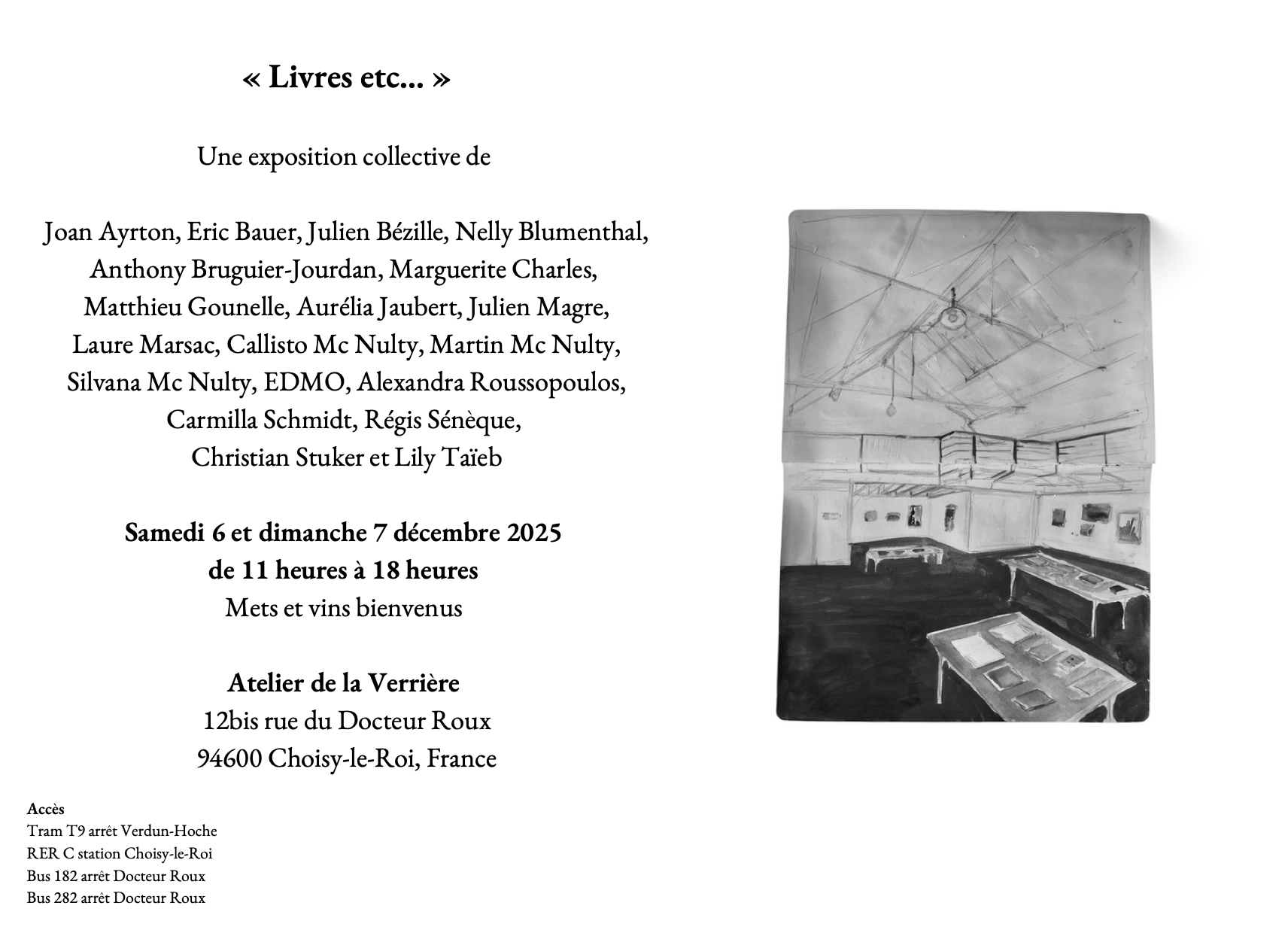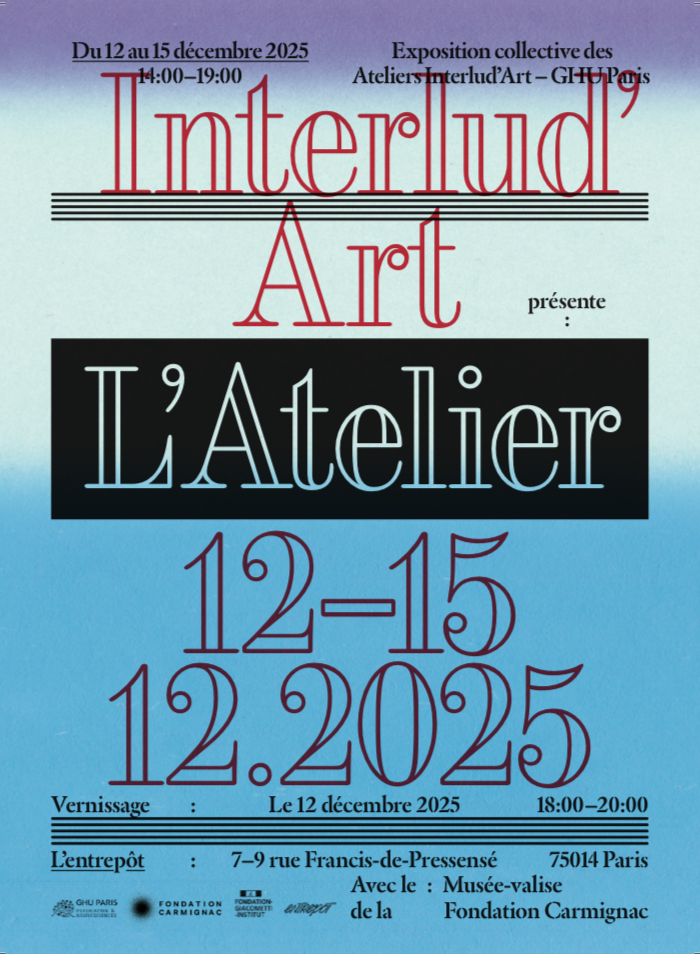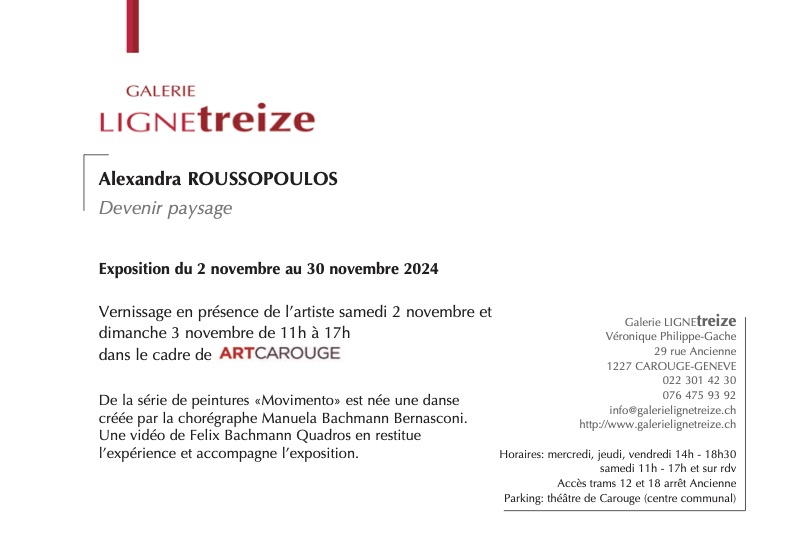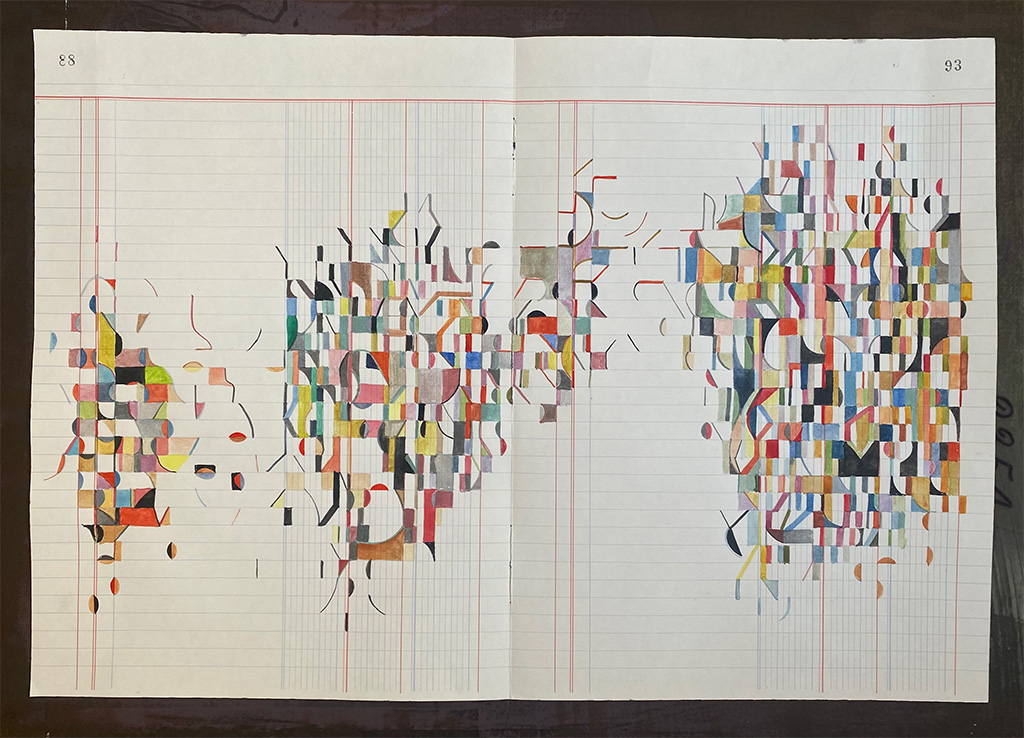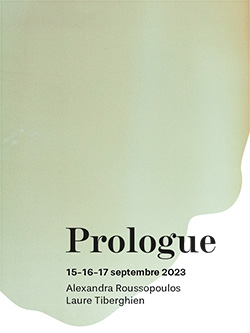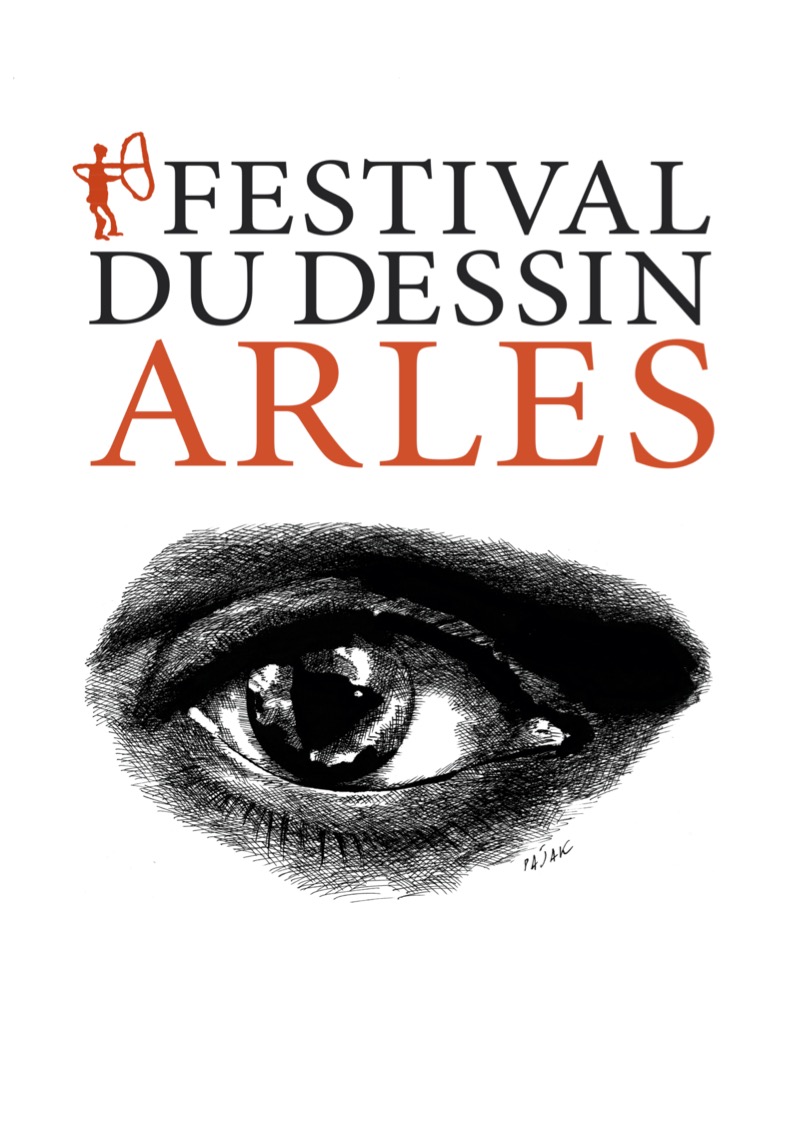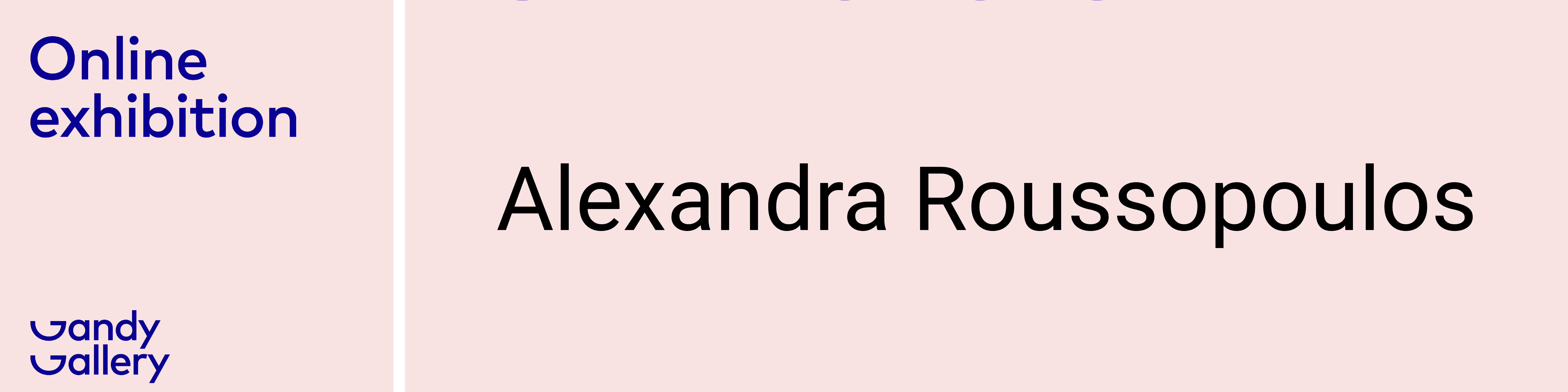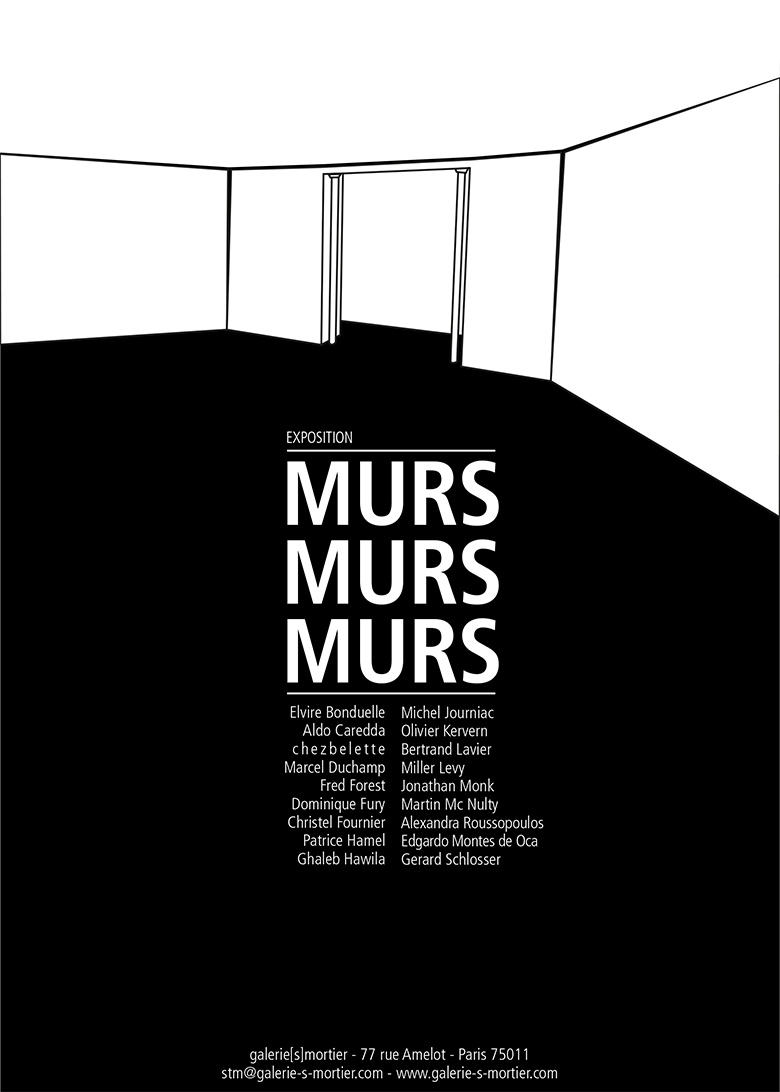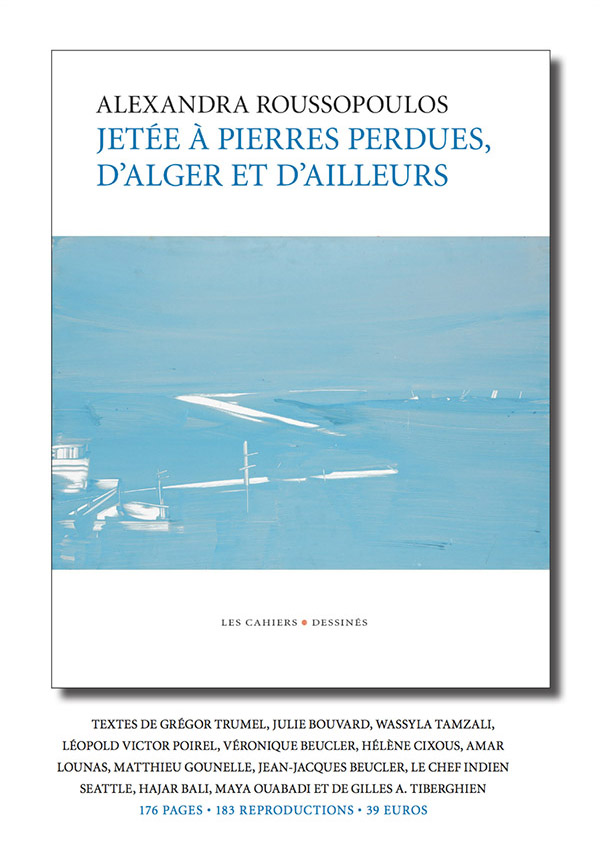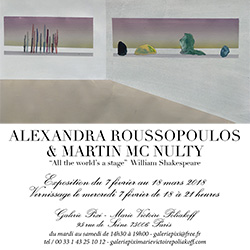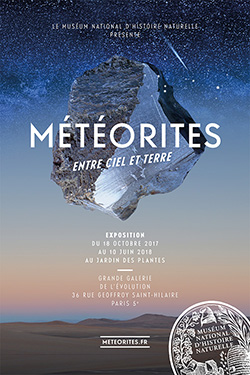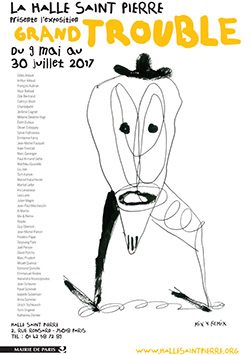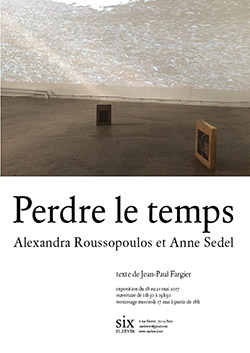Alexandra Roussopoulos was born in Paris in 1969 and is of Swiss and Greek descent. Through painting, she explores the relationship among shape, color and space. Her work has always emphasized the importance of artistic dialogue and the connection with others. She regularly collaborates in art projects and has participated in numerous artist residencies in China, Algeria, Greece, Ireland, and Slovenia.
Alexandra has participated in the activities of the APDV art center in Paris, which brings artistic action to the heart of government subsidized housing areas. She has organized and curated several exhibitions, Water and Dreams at the Kamchatka gallery in 2007, Mauvais Genre in collaboration with Isabel Duperray at a Moroccan gallery in St Nazaire in 2009 and a cycle of nine exhibitions at the Galerie épisodique. Alexandra has exhibited in Switzerland (at Art and History Museum of Neuchâtel, Louis Moret Foundation and the Manoir in Martigny, davel 14 in Cully, Villa Bernasconi in Grand-Lancy, Ferme Asile in Sion, and LAC in Vevey), in France (at L’Art dans les Chapelles, la Cité Radieuse de Le Corbusier in Marseille, the apartment/studio of Le Corbusier in Paris, Marie-Victoire Poliakoff gallery, Stéphane Mortier gallery and Scrawitch/Julien Bézille gallery in Paris), China (at Pifo gallery and the Art gallery Lelege in Beijing, Shanghai Yard Art gallery, and National Wetland Museum in Hangzhou), New-York (Zürcher gallery) and in Athens (Nitra gallery and The Project gallery).
She was awarded the visual arts prize of the René Liechti Foundation in Switzerland in 2010 and the "November in Vitry" painting prize in 2002.
She regularly participates in workshops in France and abroad (in France, at La Hear, Mulhouse and ESBA Le Mans and in China, the Academy of Fine Arts of China and the University of Fine Arts in Hangzhou).
Alexandra Roussopoulos co-wrote, with Callisto Mc Nulty and Géronimo Roussopoulos, the film "Delphine and Carole" made in 2019 (Grand Prix de Genève, selection at the Berlinale Forum 2019, SFCC Prix Télévision du meilleur documentaire, Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche, Prix du public FIFF, Étoile de la Scam 2019).
Chronology
Studied at Heatherley’s school of Art et Camberwell School of Art in London, then at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris.
1996-1999
Three main series of paintings (red, green, blue), each of them creating a different universe for each colour. Research on colour and texture, with paint applied to paper laid out on canvas. Experiments around sketchbooks. First presentation of the work on the invitation of Jan Voss at the Julio Gonzalez gallery (Arcueil, France), as part of the event « Rencontres 96 ».
A decisive encounter with gallery owners Marie Cornette and Aldo Pajarin, leading to a first solo exhibition at the Cornette-Pajarin gallery (rue du Roi de Sicile, Paris) in 1998.
Group exhibition at the Studio de l’Image in Paris.
First exhibition abroad in 1999 at the Planque Gallery in Lausanne, Switzerland.
2000-2003
The work becomes more radical, with almost monochrome paintings and square formats. Use of fluorescent colours transforming the light that hits them.
Several collaborative projects with other artists: Joan Ayrton, Eric Bauer, Jean-Baptiste Farkas, Lou Inglebert, Catherine Jacquet, Aurélia Jaubert, Martin Mc Nulty, Jean-André Orlandi, Julie Safirstein, Jean de Seynes and Romain Taieb.
Teaches Visual Arts for five years at primary school “L’École Aujourd’hui” in Paris.
In 2002, receives the International Painting Prize of the city of Vitry-sur-Seine.
Another key encounter: Marie-Victoire Poliakoff, leading in 2003 to a first exhibition at the Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery (rue de Seine, Paris).
2000
Correspondances, Carzou Foundation, Manosque, France
Galerie 29, Evian, France
Novembre à Vitry, art gallery of the city of Vitry-sur-Seine, France
2001
Swiss Embassy, Paris, France
Domaine du Tremblay, Le Tremblay-sur-Mauldre, France
2002
Correspondances, Musée Colette, Saint Sauveur en Puisaye, France
École Spéciale d’Architecture, Paris, France
Galerie municipale, Vitry-sur-Seine, France
Galerie Grande Fontaine, Sion, Switzerland
Collection of contemporary art of the city of Vitry-sur-Seine, France
2003
Museo Amadeo De Souza, Amarante, Portugal
Monasterio de San Cugat del Valles, Catalunya, Spain
Contemporary Art Fair of Montrouge, France
2004-2007
Work focusses on the temperature of colour (atmospheric colours evoking the sky and the colours of time). Gradual departure from the traditional canvas, first by rounding up the edges of the frames, then by creating her own shapes-frames: geometric forms first, then organic ones. Colour is pushed out to the edge of the painting. Plays with space, borders and changes of scale. The paintings are verging towards sculpture.
Several collaboration with the journal Architecture à Vivre (Eric and Dominique Justmann).
In 2004, exhibitions at the Parc de la Villette (Paris) during the event Vivre, c’est habiter.
Painting and drawing workshops with socially excluded and elderly people for the charity “Les Petits Frères des Pauvres”.
In 2007, curates her first exhibition L’Eau et les rêves featuring 65 artists at the Kamchatka gallery in Le Marais (Paris). The show runs for two months, with different guest curators and invited artists every week.
2004
Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France
Galerie de l’Aiguillage, Paris, France
Récidives, École Spéciale d’Architecture, Paris, France
2005
Contemporary art centre of Mourenx, France
Légèreté, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France
2006
Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France
Art Paris, Grand Palais, Paris, France
Galerie Grande Fontaine, Sion, Suisse
Paris-Spetses, Fondation Hellénique, Paris, France
Paris-Spetses, Galerie Victor Sfez, Paris, France
Format Peinture, Maison des Arts et de la culture André Malraux, Créteil, France
À la Trace, Galerie Kamchatka, Paris, France
2007
Galerie du Montparnasse with Benjamin Swaim, Paris, France
Art protects, Galerie Yvon Lambert, Paris, France
Fiac 2007, Grand Palais, Paris, France
Galerie Astrolavos, Athens, Greece
Merci, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France
Unfair exhibition, Athens, Greece
2008-2019
The shapes-paintings take over imaginary spaces, slip into images of the real world (historical archives, works of art, maps…), are hung from the walls in minimalist or baroque architectures, and interfere with existing displays in museums or in other artists’ exhibitions. They are projected in impossible projects – ones that haven’t been completed or are just too big to be built.
In 2008, creation of murals in the Aftam shelter for immigrants, working with the residents and the association Unicités.
Invited by Marie-Fabienne Aymon to show with Martin Mc Nulty at the Louis Moret Foundation in Martigny (Switzerland).
In 2008, publication of the monograph Alexandra Roussopoulos by the Louis Moret Foundation, co-published with the Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery and with financial support by the State of Valais’ council for culture. The book was designed and produced by Maxime Tétard (les Graphiquants) with texts by Elisabeth Lebovici and Brooks Adams.
In 2010, receives the René Liechti Foundation’s Visual Arts prize (Switzerland).
Exhibition in Le Corbusier’s “Cité Radieuse” and at the festival “L’Art dans les Chapelles”.
The shapes are turning into architectures and exploring tri-dimensional space.
In 2011, collaboration with landscape architects Bernard Chapuis and Georges Vafias at the Parc Mosaïc in Lille (France).
From 2010, teaches painting at Prép’art, a school preparing students to art school entry examinations.
Encounter with Yvon Nouzille, the founder of the APDV arts centre, who places art at the heart of the community, in the public spaces of council estates. In 2011, takes part in the exhibition Bonjour organised by APDV.
Artist residencies: invited by Brane Kovic to Slovenia, by Isabel Duperray to Chamalot in the region of Corrèze (France), and by John Mc Hugh to the Achill Heinrich Böll Cottage in Ireland. Each of these trips left a strong mark on the evolution of the work.
Encounter with Julien Bézille, leading to participating in one of the Scrawitch gallery’s first solo exhibitions, with independent curator Catherine Ferbos-Nakov as the exhibition’s guest curator: the first in a series of future collaborations.
Residency in Zhang Jiajie, China, with thirty international artists. First experiements with rice paper that shrouds and filters the colours to the point of making them disappear. Return to the traditional frame and canvas, with a recent series of paintings interrogating pictorial balance through the notions of composition, surface, depth and texture.
The work increasingly reflects the importance of the link to others.
The paintings are reproduced in several catalogues of solo and group exhibitions, and appear in the contemporary section of Le Livre libre (Les cahiers dessinés, 2010). A monograph, Forma fabulis, is edited by Frédéric Pajak in 2011 and published by Éditions Noir sur Blanc, in the collection “Les cahiers dessinés” (production: Lea Lund / texts: Brooks Adams, Elisabeth Lebovici, Natacha Nataf, Emmanuelle Lequeux / interview with Marie-Fabienne Aymon).
2008
Louis Moret Foundation, Martigny, Switzerland
Pixi-Marie-Victoire Poliakoff Gallery, Paris, France
Villa Bernasconi, Grand-Lancy, Suisse
Do I know you? Urban Gallery, Marseille, France
Galerija Artes, Medana, Slovenia
LREI Art Auction, New-York, USA
Charity auction for Aides, Drouot Montaigne, under the patronage of Sophie Calle, Paris, France
L’étrange beauté du monde, invited by Frédéric Pajak and Lea Lund, Villa Bernasconi, Grand-Lancy, Switzerland
Purchase by the State of Valais, Switzerland
2009
Galerie davel 14, Cully, Switzerland
Rencontres n°33, La Vigie, Nîmes, France
Papier Machine, Galerie Kamchatka, Paris, France
Shortlisted for the Mourlot prize, gallery of the École Supérieure des Beaux Arts de Marseille (ESBAM), Marseille, France
Vendanges de Printemps, Chamalot, France
Mauvais Genre, co-curated with Isabel Duperray, Galerie Petit Maroc, St-Nazaire, France
2010
Avenir incertain, utopies multiples, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France
Là-haut, invited by par Benjamin Swaim, le Sphinx, Paris, France
Espace Inventé, Espace Rachel Debreuve, Auxerre, France
Transfrontaliers, curated by Philippe Cyroulnik, Hôtel de Ville, Sochaux, France
Dialogue d’Artistes Blanc sur Fond Blanc, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff gallery, Paris, France
Pas du jeu, curated by Véronique Ribordy, le Manoir, Martigny, Suisse
Le loft Sévigné, curated by Camille Lambert, Paris, France
2011
Supercalifragilistic, Louis Moret Foundation, Martigny, Switzerland
Dépeindre, 6b, Saint-Denis, France
La nuit remue, Episodique gallery, Paris, France
2012
Les châteaux ambulants, Scrawitch gallery, Paris, France
Pullman hotel, Zhang Jiaje, China
Cent papiers et autres formes migrantes, LAC, curated by Véronique Ribordy, Vevey, Switzerland
2013
Gallery Moos, curated by Gordon Novak, Toronto, Canada
Art Gallery of Swift Current, Saskatchewan, Canada
Home sweet home, curated by Anne Destival et Callisto Mc Nulty, London, England
Yard art Gallery, Shanghai, China
2014
Dépaysages, Scrawitch Gallery, Paris, France
Insurrections, Episodique gallery, Paris, France
Déplacements, National Wetland Muyseum of China, Hangzhou, China
Nissi 2014, Artist Residency, Spetses, Greece
2015
Open door Studio, organized by Pifo Gallery, Beijing, China
Women on paper, Gallery 35, French Institute, Prague, Czech Republic
Parties communes, APDV Art Center, Paris, France
L’Échapée belle, Museum of Art and History, Neuchâtel, Switzerland
Le dépays, Solo exhibition Louis Moret Foundation, Martigny, Switzerland
Art MO, Macao International Art Fair, with Pifo New Art Gallery, Beijing, China
Feel Paris, group exhibition with Cathryn Boch, Adrien Lecuru, Joël Person and Benjamin Swaim, Art Lelege Gallery, Beijing, China
Soon Paris, limited edition art fair, with Scrawitch Editions, Paris, France
2016
Young Memories, a cycle of Nine exhibitions curated at the Galerie épisodique
Main à main, Pixi-Marie-Victoire Poliakoff Gallery, Paris
Early as snow, invited by Éric Bauer, 33 rue de Grenelle, Paris
Salon Zürcher, Zürcher Gallery, New-York, USA
Grande Fontaine Gallery, Sion, Switzerland
The poetic Community, Xiamen, Chine
Chamalot artist residency, Corrèze
Jean Fournier Gallery, Paris
Nissi 16 artist residency, Spetses, Greece
Salon Zürcher, galerie Zûrcher, New-York, USA
Pifo Gallery, Beijing, China
2017
15 villa Seurat, commissariat d’exposition Joan Ayrton et Alexandra Roussopoulos, Paris, France
Peindre dit-elle, commissariat d’exposition Julie Crenn, Musée des Beaux-Arts de Dole, France
Résidence d’artiste Les ateliers sauvages, invitée par Wassyla Tamzali, Algiers, Algeria
Annual abstract art group show, Pifo Gallery, Pékin, Chine
Grand trouble, La Halle Saint Pierre, Paris, France
Perdre le temps, avec Anne Sedel, Galerie Six Elzevir, Paris, France
Météorites, entre ciel et terre, Museum d'histoire naturelle, Paris, France
Partir avec les murs, Fondations Louis Moret, Martigny, Switzerland
2018
Solo shows
All the world’s a stage, with Martin Mc Nulty, Galerie Pixi-Marie-Victoire Poliakoff, Paris, France
Venue revenue, Institut Français, Algiers, Algeria
Transient, Gare du Nord’s Eurostar business Lounge, curated by The Hospital Club and the Baldwin Gallery, Paris
Un mur, un tableau curated by Miquel Mont, École Nationale Supérieure de Paris-Belleville, Paris, France
Group shows
La quatrième, davel 14, Cully, Switzerland
L’Entre-Deux curated by Jonathan Taieb and Gaya Goldcymer, Galerie Episodique, Paris
Bibelot curated by Callisto Mc Nulty, Wendy Gallery, Paris
Women on Paper, curated by Nadine Gandy, Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux, France
Tua Hua Tan 2nd International Artist Retreat and Residency, Modern Art Museum, Heifei, China
Supreme buddhism and art, curated by Wang Chunchen, Putian Museum, China
Five ladies, Kibela Gallery, Maribor and Galerija Antikvitete Novak, Ljubljana, Slovenia
Glass cloud Gallery, London, England
Dessin politique, dessin poétique curated by Frédéric Pajak, Musée Jenisch, Switzerland
Residencies
Les ateliers sauvages, invited by Wassyla Tamzali, Algiers, Algeria
Nissi 18, artist residency, Spetses, Greece
Tua Hua Tan 2nd International Artist Retreat and Residency, China
Books
Dessin politique, dessin poétique, Editions les Cahiers dessinés
2019
Solo shows
Jetée à pierres perdues, d’Alger et d’ailleurs, galerie Stéphane Mortier, Paris, France
Transient, Gare du Nord’s Eurostar business Lounge, curated by The Hospital Club and the Baldwin Gallery, Paris, France
Group shows
Man on the moon - 50 years after, curated by Alexandros Maganiotis and text by the art historian, Yannis Bolis, The Project gallery, Athens, Greece
Novembre à Vitry / 50 ans 1969-2019, art gallery of the city of Vitry-sur-Seine, France
Galeristes 2019 - 4e édition, Carreau du temple, Paris, France
Apollo XI - la Lune, Mars- Météorites, Lucien Paris, Drouot, Paris, France
Women imprinted, h club London gallery, London, England
Draw art fair- London, Saatchi gallery, London, England
Hors les mur[s][s]ur les murs, Stéphane Mortier gallery, Paris, France
Fête du court métrage 2019, atelier W, Pantin, France
Les Ateliers 1, 2, 3... invited by Wassyla Tamzali, Algiers, Algeria
[quotidien d’atelier], EP7, Stéphane Mortier gallery, Paris, France
formes + couleur curated by Marion Delage de Luget, Chamalot-Paris, France
J'y pense longuement... Mais à qui va ma pensée ? Placido gallery, Paris, France
Residencies
Epitopou, artist residency, invited by Eva Bony-Tourtoglou, Andros, Greece
Books
Jetée à pierres perdues, d’Alger et d’ailleurs - Editions les Cahiers dessinés (2019)
Film
Delphine et Carole, insoumuses, directed by Callisto Mc Nulty, written with Alexandra Roussopoulos and Géronimo Roussopoulos (Arte), selected at the 49th Berlinale Forum (2019)
(SFCC Prix Télévision du meilleur documentaire, Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche, Grand Prix de Genève, Prix du public FIFF)
2020
Solo shows
Behind the horizon, Nitra Gallery, Athens, Greece
Showroom des Ateliers Pinton, Paris, France
Venue revenue, French Institute of Algiers, Algeria
Group shows
Chroma, Des matières et des couleurs, with Sophie Panourgias, Atelier des Sablons, Paris, France
Les Authentiques, Galerie Pierre Alain Challier, Paris, France
The island within, Adamantia Art Space, Andros, Greece
Space Média 2020, de Fred Forest, galerie Stéphane Mortier, Paris, France
H club, London, England
Drawershow, davel 14, Cully, Switzerland
Logical freedom, EPOCH Art Museum, Wenzhou, represented by with the Pifo Gallery, Beijing, China
Murs murs murs, galerie Stéphane Mortier, Paris, France
Films
Les vases communicants, co-directed with Olivia Lefebvre and Lola Levent, voice Lou LRC (03:15)
Faut-il se souvenir de la nuit? film co-directed with Albane Gayet, 33rd edition of Instants vidéo, Friche la belle de mai in Marseille (05:49)
Here and There, co-directed with Aurélia Jaubert (18:49)
Books and editions
Les Authentiques/Les Pionnières II- photographs: Catherine Panchout, texts: Yves Michaud, Éditions Flammarion
Loin la mer, Éditions Naima, digital art publisher, poetry: Matthieu Gounelle, paintings: Alexandra Roussopoulos
Publication Apdv, a crossing of the HLM 4001 Porte de Vincennes group 2009-2019
Venue Revenue, Éditions Motifs
Plaiso and Kinisi carpet edition, Maison Pinton
Chroma, a series of bags inspired by paintings, with Sophie Panourgias
2021
Solo shows
Natures vivantes, galerie oblique, Martigny, Switzerland
Group shows
AD Matières d’art,represented by Pinton, Palais d’Iena, Paris, France
On the walls, galerie Stéphane Mortier, Paris, France
Group show, Nitra Gallery, Thessaloniki, Greece
Art Athina, represented by Nitra Gallery, Greece
1 commode, 2 vases, 5 machines à laver, 1 tapis, 1 robe, 36 téléphones, 1 tableau, with Anne Sedel and Roger Landault, villa d’Alsace, Paris, France
2nd edition of Chana Orloff and the Villa Seurat, organised by Les Ateliers-musée Chana Orloff as part of the Cultural Summer and the European Heritage Days, Paris, France
KI-NIMATA,curated by Katerina Nikolaou with the support of the Bouboulina Museum, Spetses Island, Greece
Dialogues, galerie Épisodique, Paris, France
My pleasure ! Donations, etc. 2000-2020, Musée d’art du Valais, Sion, Switzerland
Books
Natures vivantesco-edited by FOVAHM (Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales), galerie Oblique et davel 14, graphics by Christian Stuker
2022
Solo shows
Art and Nature, Ecclesiastical Museum of Spetses with the support of The Community Trust Spetses and the Anargyrios and Korialenios School, Spetses Island, Greece
Group shows
The Revival of the Stones , curated by Stella Christofi, Troupakis-Mourtizinos fortified complex, Kardamili, Greece
Maison Bruneau, invited by the association R.A.S, Paris, France
Back to Athens, invited by Efi Michalarou, Palace Isaiah, Athens, Greece
Je marche mieux quand ma main serre la tienne, with Joan Ayrton, Jardins du Trocadéro, Paris, France
Ceramic Art Painting and Sculpture, Mon Coin Studio, Athens, Greece
Bienvenue Art Fair, invited by Marie-Victoire Poliakoff, Hotel La Louisiane, Paris, France
Residencies
Art and Nature, artist residency and children's workshops with the support of The Community Trust Spetses and the Anargyrios and Korialenios School of Spetses, Greece
Books
Plaidoyer pour la beauté, L’Amour N°3, by Frédéric Pajak
The Revival of the Stones, by Stella Christofi
Habiter la couleur, M le magazine du Monde, text by Aude Goullioud, photos by Paul Lehr
2023
Solo shows
Festival du Dessin, invited by Frédéric Pajak, Arles, France
Waterscapes, Gandy Gallery, Bratislava, Slovakia
Tumultes, Luma, Arles, France
Fenêtre sur Hodler, invited by Véronique Ribordy, Geneva, Switzerland
Prologue, with Laure Tiberghien, Moments artistiques, Paris, France
2023
Group shows
Art Athina, invited by Nitra Gallery, Athens, Greece
Faire corps, a proposal by Régis Sénèque, Marguerite Milin gallery, Paris, France
Projects
La vie des choses organised by the association Orange Rouge with a SEGPA class at the République secondary school in Bobigny, France
Artistic direction of the Arles Festival educational project, Les enfants d’Arles exposent, Espace Van Gogh, Festival du Dessin, Arles, France
Curator of the exhibition Dessin du temps présent at the Espace van Gogh, Festival du Dessin, Arles, France
Residencies
Writing residency, Fondation Les Treilles, created by Anne Gruner Schlumberger, Haut Var, France
2024
Solo shows
V-ZUG studio, Paris, France
Group shows
Sur l'envers, Poush, curated by Andréanne Beguin and Corinne Digard, Aubervilliers, France
Projects
Artistic direction of the educational project Les enfants d'Arles exposent, Espace Van Gogh, Festival du Dessin, Arles, France
Curator of Dessinatrices d'Aujourd'hui, Espace Van Gogh, Festival du Dessin, Arles, France
Residencies
Artist residency, Odradek, Brussels, Belgium
Artist residency, Fondation Casa Atelier Bedigliora, Ticino, Switzerland